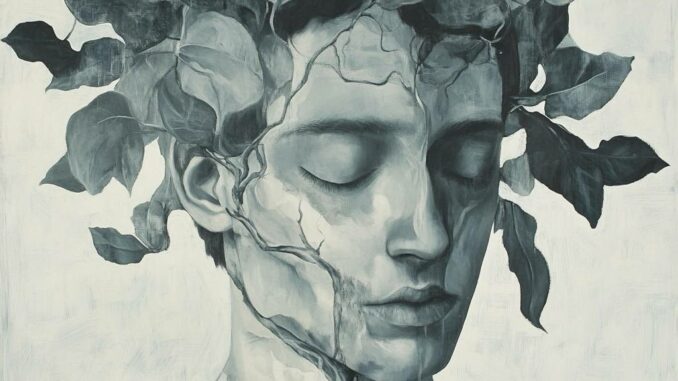
Traduction d’un article de Hartmut Traub publié en 2023 dans la revue Steiner Studies, Volume 4. DOI : 10.12857/STS.951000440-14. Licence : CC BY 4.0.
Titre original : Hellsehen. Entwicklungsgeschichte und Systematik eines problematischen Theorems bei Rudolf Steiner Versuch einer ersten Annäherung.
Résumé
La clairvoyance est l’une des catégories centrales de l’ésotérisme. La vision du monde et l’épistémologie philosophico-anthroposophiques de Rudolf Steiner utilisent également ce concept dans leur conception de la « connaissance supérieure ». Cependant, l’idée de la clairvoyance chez Steiner ne peut pas être comprise, ou seulement de manière limitée, si l’on se réfère à ce qu’il appelle les formes « anciennes » ou « naturelles » de la clairvoyance, car son idée d’une « nouvelle » forme de clairvoyance diffère fondamentalement de ce qui a été transmis dans les textes classiques et les études sur les phénomènes de clairvoyance. L’article en question examine et développe le concept spécifique de la clairvoyance de Steiner selon trois axes : d’une part, il reconstitue les éléments constitutifs de la conception de Steiner d’une clairvoyance moderne « basée sur la pensée » en examinant les notions de clairvoyance attribuées à la « tête », au « cœur » et à l’« abdomen » et en discutant le motif christologique fondamental du « Mystère du Golgotha ». En outre, l’article tente d’inscrire l’idée de clairvoyance multidimensionnelle de Steiner dans le contexte de l’histoire des idées, en s’appuyant sur des exemples littéraires choisis et sur les résultats des recherches modernes sur la conscience. Enfin, l’article cherche à déterminer si et dans quelle mesure les idées complexes de Steiner sur la « nouvelle clairvoyance » peuvent nous aider à réfléchir aux possibilités et aux limites d’un modèle multidimensionnel élargi de la cognition et de l’expérience humaines.
Mots-clés : ésotérique – exotérique ; clairvoyance moderne vs ancienne ; contextualisation historique du travail et des idées ; intelligence physiologique, émotionnelle, sociale et cognitive ; multi-perspectivité
1. Introduction et mission
1.1 « Clairvoyance » : un concept provocateur et encombrant
L’utilisation du mot « clairvoyance » provoquera très probablement des froncements de sourcils étonnés dans tout contexte de conversation contemporain. Est-il possible pour un contemporain rationnel et éclairé d’aborder ce sujet de manière sensée ? Ou bien la notion de « clairvoyance » appartient-elle davantage au cabinet poussiéreux des curiosités culturelles amusantes ou, comme une incitation à un scepticisme dédaigneux, au rang des obscurantismes ésotériques ? Comme le soi-disant bon sens de l’homme moderne éclairé est plutôt défavorable à la question de la clairvoyance, le discours académique sera encore moins susceptible de prendre ce sujet au sérieux. Il peut certes être considéré comme un phénomène de l’histoire culturelle, sociale et intellectuelle, comme un aspect de la parapsychologie et peut-être même comme un domaine limite de l’épistémologie. Mais peu d’universitaires la considéreront comme une approche sérieuse pour élargir de manière critique et constructive nos connaissances psychologiques, anthropologiques, éthiques, cosmologiques ou théologiques.
Cet article tente d’éliminer le caractère provocateur et encombrant du mot « clairvoyance » en recourant à l’idée de Steiner d’une connaissance « améliorée » ou « supérieure », par une approche multidimensionnelle et en la démythifiant.
L’application pratique de cette approche typologique et différenciée de la vision du monde et de l’ordre surnaturel – avec ses entités, ses perceptions de la couleur, du son, de la température et de la forme, du cosmos, de l’histoire géologique et humaine, et l’investigation critique-herméneutique et existentielle-ontologique de ceux-ci (qui dépasserait les limites de cette étude) – ne peut être entreprise ici. Une telle analyse critique et sa concrétisation devraient être réalisées ultérieurement de manière détaillée en utilisant les repères et points de référence épistémologiques discutés ici.
1.2 L’approche ésotérique de Steiner dans l’histoire des idées
Contrairement à Blavatsky, Olcott et Judge (c’est-à-dire les fondateurs de la Société théosophique), Steiner n’a pas développé son approche du phénomène de la clairvoyance par le spiritisme, mais plutôt par le biais de la philosophie, en particulier de l’idéalisme allemand. Sa compréhension historique de l’idéalisme allemand ne limite pas cette tradition philosophique à Kant, Fichte, Schelling et Hegel. Pour lui, les contemporains de ces penseurs – Herder, Jung-Stilling, Goethe, Schiller, Novalis et d’autres philosophes et poètes du début du romantisme, tels que Schleiermacher, Tieck et les Schlegel – appartiennent également à cet environnement intellectuel. De plus, la philosophie de l’idéalisme allemand, telle que Steiner la comprend, inclut également (qu’il s’en distancie de manière critique ou qu’il s’en démarque de manière apologétique) des précurseurs de l’idéalisme, tels que Leibniz, Hume, Descartes et Spinoza, mais aussi des critiques de l’idéalisme tels que Jacobi et Hamann, ainsi que certains de leurs successeurs, comme Immanuel Hermann Fichte, Schopenhauer, Feuerbach, Stirner, Nietzsche, et des représentants du néo-kantisme (voir son livre Les énigmes de la philosophie, SKA 4 1/2).
En poursuivant son chemin philosophique vers l’ésotérisme, Steiner a fait progresser ses propres intérêts intellectuels, mais s’est également confronté au dogmatisme catholique de ses origines provinciales. Pendant ses études à Vienne, il a été inspiré par des maîtres idéalistes tels que Karl Julius Schröer
Outre son intérêt pour la philosophie, Steiner a également été fasciné très tôt par l’occultisme et l’ésotérisme ; il en fait lui-même état dans son autobiographie (GA 28, 60f.).
La proximité entre philosophie et ésotérisme n’est pas propre à la pensée de Steiner, du moins dans le contexte de la philosophie de l’idéalisme allemand. Des représentants éminents de la philosophie idéaliste, tels que Kant, Schiller, Schelling, Fichte père et fils, ont également mené des études sur des phénomènes parapsychologiques tels que la clairvoyance, la vision spirituelle ou le mesmérisme. Ce faisant, ils ont développé des idées fondamentales concernant leur sérieux, leurs avantages et leurs inconvénients, en particulier dans le contexte du développement de l’identité et de l’ego. Schelling s’est particulièrement attaché à interpréter la pensée mythologique, qui est devenue importante pour la pensée de Steiner. Fichte a discuté du danger de perdre le contrôle de soi dans l’état de clairvoyance, et Schiller a fait référence à la charlatanerie dans ce domaine.
Pour trouver un juste milieu entre la philosophie de l’idéalisme et l’intérêt porté aux phénomènes parapsychologiques, il convient également de se référer, dans ce contexte, à l’histoire de la réception des traditions mystiques et à la religiosité piétiste de l’intériorité, tant en ce qui concerne l’idéalisme en général
C’est cette généalogie de l’histoire des idées qui distingue de manière significative la pensée ésotérique de Steiner et sa théosophie – et donc sa conception de la clairvoyance – des écoles théosophiques établies vers la fin du XIXe siècle, qui étaient largement orientées vers les pratiques spiritualistes, la sagesse de l’Inde ou l’étude comparative des religions. Cette différence d’approches intellectuelles préfigure le schisme qui se produira entre la théosophie et l’anthroposophie.
2. Les étapes du développement de la clairvoyance
2.1 « Ancienne » et « nouvelle » clairvoyance dans l’histoire des idées
Dans sa conférence « Über das rechte Verhältnis zur Anthroposophie » (De la juste relation à l’anthroposophie), donnée le 13 novembre 1909 à Stuttgart devant les membres de la Société anthroposophique, Steiner a déclaré :
Il vaut mille fois mieux saisir au préalable les idées spirituelles par la pensée, puis […] s’élever ensuite soi-même dans les mondes spirituels, que de voir d’abord sans pouvoir saisir ce qu’on a vu par la pensée. Il vaut mille fois mieux ne rien voir que de voir quelque chose et ne pas avoir la possibilité de le pénétrer par la pensée, car dans ce cas, l’incertitude s’installe [dans l’anthroposophie]. (GA 117, 86)
Outre l’affirmation du rôle crucial de la pensée dans la vision spirituelle, cette déclaration implique à la fois une critique de ceux qui rejettent une approche philosophique de l’anthroposophie et marque une distinction systématique entre une forme de clairvoyance « ancienne », primitive et naturelle, et une forme « nouvelle », qui peut être développée selon un processus contrôlé. La différence entre ces deux formes de clairvoyance est marquée par le développement de la pensée. Dans l’approche de Steiner sur le développement intellectuel, l’état actuel d’évolution de la conscience humaine exige plus que l’acceptation volontaire de phénomènes prétendument surnaturels ou la croyance soumise à l’autorité spirituelle et au charisme d’un leader spirituel. Dans ce paradigme anthroposophique, il n’est pas possible d’accéder aux « mondes supérieurs » du savoir spirituel par les méthodes du spiritisme traditionnel ou les rites d’initiation. Contrairement à la croyance en l’autorité et à l’effet de surprise pour les curieux, la « nouvelle » forme de clairvoyance, ou la forme développée, est basée sur le postulat de la liberté et nécessite une clarté de conscience et d’esprit. Elle dépend d’une cocréation active et contrôlée par la pensée, ainsi que de la participation consciente de l’individu à la création, au développement et à l’observation critique des processus cognitifs ésotériques. Par conséquent, l’impératif méthodologique de Steiner pour sa nouvelle forme de clairvoyance se présente comme suit : « Acceptez le moins possible par simple foi, mais évaluez, examinez ; non pas de manière partiale, mais impartiale ! C’est ce qu’il faut souligner avant tout » (GA 117, 75).
Le principe qui constitue le centre spirituel de la méthodologie anthroposophique de Steiner est donc son origine philosophique, qui modifie la philosophie idéaliste traditionnelle concernant la nature de l’illumination, à savoir que rien « ne doit être considéré comme existant ou comme contraignant, sauf ce que l’on a clairement saisi et compris ».
Le concept de Steiner d’une pensée critique et inventive, qu’elle soit partagée ou individuelle, dans le domaine de l’occulte (qui caractérise sa nouvelle forme de clairvoyance) semble au premier abord être un motif de la philosophie des Lumières. Cependant, il fait remonter son origine au-delà de l’époque des Lumières, à des origines christologiques et cosmologiques, qu’il appelle « l’impulsion du Christ » et « l’Ego de l’humanité » (GA 152, 39f. ; GA 143, 163). Autrement dit, l’incarnation de Dieu en la personne de Jésus et sa mort temporaire sur la croix du Golgotha sont considérées par Steiner comme le paradigme cosmologique et anthropologique pour l’interprétation de l’essence de l’homme moderne. La prise de conscience de l’échec provisoire, mais néanmoins nécessaire, de la mission divine de Jésus face à la résistance institutionnelle se transforme en reconnaissance (éclairante) de la vérité de son message pour (a) la résurrection assurée de son esprit et (b) l’accomplissement de sa mission divine dans l’autodétermination individuelle et anthroposophique (c’est-à-dire c’est-à-dire dans une participation « éclairée » et spirituellement active à la cocréation d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre).
Élément constitutif de la doctrine théosophique et anthroposophique de Steiner et de son interprétation de la clairvoyance, la pensée en tant que condition préalable trouve ses racines dans la philosophie idéaliste de l’esprit. Cependant, des sources idéalistes peuvent également être discernées dans l’interprétation christologique spécifique de cette condition préalable. Steiner lui-même y fait expressément référence et justifie souvent la tâche de redécouverte et de construction de la vision intellectuelle en se référant à l’Introduction à la doctrine de la science de Fichte de 1813. Les enseignements de Schelling et de Fichte concernant la perception intellectuelle (intellektuale Anschauung) ont dès le départ
Il convient également de mentionner la vision différenciée de Steiner sur le mysticisme, qui s’explique par sa réception de l’idéalisme. S’il croit d’une part que le mysticisme a en son cœur le potentiel d’offrir une voie vers la vérité, il rejette d’autre part de manière critique certaines formes de mysticisme en tant que philosophie élitiste du savoir et de l’initiation, fondée uniquement sur la révélation intérieure du divin.
Pour comprendre et interpréter le concept de clairvoyance de Steiner, il est fondamental de faire la différence entre une forme « ancienne », primitive, naturelle et non conceptuelle (GA 117, 91) et une forme « nouvelle », moderne et développée intellectuellement. L’influence de l’idéalisme allemand sur Steiner, sa compréhension différenciée du processus d’illumination et sa christologie bien pensée sont décisives pour comprendre cette distinction.
2.2 La métamorphose de l’« intuition morale » en concept de « connaissance supérieure »
Déjà dans sa Philosophie de la liberté, et avant cela dans son ouvrage d’épistémologie Vérité et science, Steiner aborde un concept philosophique de connaissance supérieure, qui repose sur la (re)découverte et le développement d’un organe intellectuel spécial et de ses capacités. Le modèle de Steiner d’une épistémologie progressive et graduellement élargie culmine dans la conception d’une « imagination morale ». Développée dans Philosophie de la liberté (PF, 197-211), cette idée est basée sur l’acte de pensée évident du « je », mais elle intègre également la « connaissance théorique », la « volonté » et le « sentiment », la « spontanéité » (pensée) et la « réceptivité » (perception), ainsi que « l’individualité » et « l’universalité ». En tant que point culminant d’un modèle holistique de la connaissance, l’imagination morale caractérise la capacité à saisir des idées « morales » (c’est-à-dire des intuitions éthiques, scientifiques, esthétiques, politiques et religieuses à caractère universel), à découvrir leur point de départ dans une situation empirique concrète et à développer et appliquer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des « intuitions morales » dans des relations et des situations pratiques. Ces dernières illustrent l’idée de Steiner d’une « technique morale » (PF, 200)
Le modèle de Steiner d’un processus cognitif approximatif et intégratif s’étend de la simple perception sensorielle à l’intuition d’une « vie en Dieu » (ibid., 246), qui véhicule l’individualité et l’universalité. Ce modèle peut être compris comme la base philosophique et le support interprétatif de l’approche de Steiner (a) d’une « conception scientifique secrète » d’une « connaissance des mondes supérieurs » et (b) du « mode de connaissance par clairvoyance ». On peut même interpréter cette transformation de la philosophie en ésotérisme comme une métamorphose de la philosophie de Steiner. Cependant, la base philosophique et intellectuelle de cette transformation ne doit pas être abandonnée ni même rejetée : c’est un facteur constitutif et stabilisateur qui prend une nouvelle forme.
2.3 Le « monisme corps-âme » de la clairvoyance
À partir de son introduction à l’idéalisme, Steiner a conçu sa propre philosophie comme une variante de « l’idéalisme objectif » (SKA 2, 15). Ses idées reposaient sur l’hypothèse fondamentale d’une unité holistique originelle de l’être qui exprime de manière vivante la matérialité et l’idéalité. Une unité qui, par l’effet de séparation de différents points de vue, apparaît comme divisée en un monde matériel et un monde spirituel ainsi qu’en l’opposition du corps et de l’âme. Kant avait tenté de résoudre ce problème de médiation entre le monde sensible et le monde intelligible dans sa Critique de la raison pure en introduisant ses idées sur l’imagination et sa théorie de la raison pure. L’idéalisme réel de Fichte (qui suppose que les idées ont non seulement un potentiel idéal de création, mais aussi un potentiel réel) a étendu au domaine de l’intelligible le concept de réalité substantielle et a ainsi renforcé la conception de la pensée à la première personne ainsi que celle de l’imagination productive en tant que pratique morale et artistique (au sens existentiel). La philosophie naturelle de Schelling, en revanche, mettait l’accent sur une forme de réalisme idéal – d’une manière similaire à Goethe – en postulant le caractère idéal de la réalité et en développant une philosophie de l’art qui tentait de réaliser une synthèse productive des mondes sensible et suprasensible.
Le concept qui englobe ces différentes approches en tant qu’« aboutissement de l’idéalisme »
L’approche de l’ésotérisme par Steiner, éminemment philosophique, et la primauté qui en résulte d’une cocréation personnelle, intellectuelle et participative des processus cognitifs ésotériques (primauté caractéristique de sa nouvelle forme de clairvoyance), associées à son monisme (théorique et pratique) fondé sur l’intuition morale, sont les principes fondamentaux à partir desquels son concept de clairvoyance doit être compris et discuté. Pour Steiner, l’aspect déterminant de son modèle moniste ou holistique de la clairvoyance est la tentative implicite d’appliquer et de rendre fructueux l’élément épistémologique du « voir » à différents niveaux physiologiques. Cela ouvre des modes de connaissance et des dimensions qui vont au-delà de la rationalité cognitive et de la sensibilité au sens strict, mais qui révèlent en même temps une qualité de vraisemblance qui les caractérise comme des modalités d’expériences qui ne sont que « semi-occultes » En tant que tels, ils ne sont pas du tout étrangers à l’intuition quotidienne ou à des domaines analogues de la recherche scientifique.
Dans ce qui suit, nous présenterons brièvement les différents modes et champs de la nouvelle forme de clairvoyance de Steiner, ainsi que leur fonction de médiation entre la matérialité et l’idéalité, en nous référant à des idées comparables tirées de concepts existants, de contextes littéraires et de discours scientifiques.
2.3.1 Clairvoyance, clairaudience et lecture clairvoyante
Contrairement au mot « clairvoyance », la notion de « clairaudience » (Hellhörigkeit) est bien ancrée dans le langage courant en Allemagne et ne provoque guère d’irritation. Hellhörig signifie prendre conscience de quelque chose en écoutant attentivement ce qui a été dit ; on saisit quelque chose qui n’est pas mentionné de manière audible mais qui transparaît comme un non-dit qui se révèle. Ainsi, une personne hellhörig découvre des significations et des motivations cachées dans les paroles, que l’orateur dissimule délibérément ou veut souligner sans le dire. Quiconque devient hellhörig entend « l’herbe pousser », comme le dit l’expression. Les personnes hellhörige peuvent répondre, aborder et discuter des signaux émis par leur interlocuteur dans une conversation pour mieux comprendre ce qui était réellement signifié.
La théorie moderne de la communication de Friedemann Schulz von Thun (1981) parle au sens figuré de quatre oreilles ou quatre becs avec lesquels les messages peuvent être perçus ou prononcés. Les informations peuvent être des déclarations sur la relation des interlocuteurs ou des communications personnelles de l’orateur. Elles peuvent également faire référence à des aspects factuels de la communication ou à des aspects qualitatifs du discours.
L’idée de clairaudience de Steiner, à savoir l’audition « spirituelle » ou « occulte » (GA 156) ou « l’écoute à travers » (GA 161, 213), contient essentiellement les mêmes idées que la théorie moderne de la communication de Schulz von Thun. La seule différence réside dans l’idée selon laquelle ce qui peut être entendu par clairaudience au sens ésotérique provient d’une dimension spirituelle ou occulte de la réalité. Dans cette perspective, l’« ouïe occulte » ne se concentre pas sur les nuances psychosociales de la communication, mais sur le contenu spirituel. Cela n’exclut pas, cependant, la possibilité que l’ouïe élargie puisse également entrer en jeu dans des contextes de communication et d’interaction interpersonnelles.
Dans ses déclarations sur les « mondes supérieurs », Steiner prend en compte la dimension de la « Parole de Dieu », tant dans son sens théologique et biblique au sens strict que dans son sens théologique plus large. En d’autres termes, le modèle de l’audition occulte de Steiner est partiellement construit à partir d’une perspective mythologique naturelle (esprits élémentaires) et d’une cosmologie panpsychique (âme du monde). Dans le contexte de cette perspective, on peut comprendre la tentative de médiation entre « l’audition occulte » et la « lecture occulte ». Comme pour l’écoute, l’assimilation du sens par la lecture nécessite une ouverture à des dimensions plus profondes du sens, à l’intérieur ou au-delà du mot écrit, en particulier lors de la lecture de textes à forte charge spirituelle. Pour Steiner, la différence entre la parole inspirée et la communication littérale, entre « la langue vivante et la langue morte », joue un rôle central dans la compréhension du lien entre « l’esprit » et « la lettre ». Ce sujet a déjà fait l’objet de discussions approfondies par Paul (Romains 7:6) et plus tard par Augustin, Luther et surtout Fichte.
En ce qui concerne la méthodologie sémantique des écrits pédagogiques de Steiner sur la « connaissance supérieure », les recherches récentes mettent l’accent sur une approche herméneutique plutôt que dogmatique et doctrinale.
Comme pour la clairaudience et la lecture clairvoyante, la vision clairvoyante au sens strict consiste à sensibiliser et à élargir la vision physiologique et intellectuelle. En d’autres termes, la vision clairvoyante consiste en une considération multidimensionnelle du monde qui va au-delà (a) d’une vision empirique, sensorielle et « matérialiste », toujours teintée d’idéologie, et (b) de la signification attribuée aux choses en termes d’histoire culturelle. Ces perspectives incluent, par exemple, des lectures poétiques, esthétiques, religieuses ou mythologiques du monde et de la nature, ainsi que de leurs composantes phénoménales. Cependant, le modèle de clairvoyance de Steiner exige que ces approches de l’interprétation fassent leurs preuves en termes de pensée. Les significations saisies et transmises dans les différents modes de clairvoyance doivent être accessibles à une analyse critique existentielle et ontologique (c’est-à-dire que les connaissances qu’elles permettent d’acquérir doivent ensuite s’avérer pertinentes pour l’interprétation de l’existence humaine dans son ensemble et, de plus, résister à une analyse critique différenciée). Cela est facilité par le fait qu’ils peuvent être justifiés et présentés de manière convaincante à partir de l’approche méthodologique du monisme à perspectives multiples.
L’approche moniste fait émerger un problème spécifique dans la conception de Steiner de sa nouvelle clairvoyance fondée sur la pensée : façonnée par l’influence de l’idéalisme de Kant, Fichte et Schelling, elle conçoit l’image vivante et le concept comme une forme de « pensée » picturale
D’un point de vue historique, le mode de connaissance (appelé « intuition morale » dans la Philosophie de la liberté de Steiner) représente déjà une conception moniste. Steiner affirme que le monde des choses représenté dans la perception externe n’est pas seulement inhérent aux structures conceptuelles de la pensée – que ce soit en tant qu’acte constitutif transcendantal (Kant) ou en tant que force de jugement contemplative (Goethe) – mais qu’il constitue également un impératif esthétique et moral (c’est-à-dire pratique) qui appelle à son développement ultérieur. Cela signifie qu’une dimension spirituelle peut être reliée au matériel et se trouver dans celui-ci, ce qui appelle à la continuité de sa conception matérielle ou idéale (cf. SKA 2, 182). Et inversement, à partir de l’idée de « technique morale », émerge dans le domaine du spirituel et moral une structure adéquate qui correspond à la matérialité du monde sensible (ibid., 206).
En ce qui concerne le phénomène de la clairvoyance ésotérique-occulte, la théosophie de Steiner fait référence à une dimension christologique dominante : l’interpénétration de la « parole » et de la « chair » – « et le Verbe s’est fait chair » (Jean 1:14) – se trouve au centre des discussions de Steiner sur le monisme.
Ces subtilités de congruence et de différence doivent être prises en compte lors de la critique et de l’interprétation des écrits et des conférences de Steiner afin d’éviter les malentendus grossiers. Ces malentendus trouvent de nombreuses sources d’inspiration, en particulier lorsque les spécialistes de Steiner adoptent une approche trop littérale, voire polémique, de ses points de vue subversifs, mais néanmoins poético-esthétiques ou mythologico-religieux, qui combinent langage pictural et symbolique. Lorsque cela se produit, les possibilités intrinsèques d’élargissement multidimensionnel du champ de vision, qui sont censées caractériser le modèle de clairvoyance de Steiner, ne sont pas considérées de manière herméneutique et critique ; elles sont plutôt ironiquement ignorées, interprétées au sens littéral (et donc « sans inspiration ») ou carrément rejetées comme des fantasmes dépassés. Cependant, le traitement des œuvres théosophiques et anthroposophiques de Steiner ne doit pas nécessairement être fondé sur une attitude aussi partiale et défensive. Le problème de l’intégration de la perception et du concept dans un modèle moniste, comme c’est le cas dans les œuvres de Steiner, révèle le point crucial de toute épistémologie qui repose sur les facultés d’imagination et de perception : elle submerge notre esprit, qui a « besoin d’images »
Une vision qui intègre et élargit les horizons, comme celle que Steiner appelle la « nouvelle clairvoyance » (mais aussi les notions de clairaudience et de lecture clairvoyante), peut s’avérer utile. Dans le contexte d’un cours de biologie, utiliser la clairvoyance ou la multi-perspectivité permettrait d’examiner un organisme non seulement comme un spécimen conditionné – que ce soit sur le bureau de l’enseignant, la table de dissection ou dans une éprouvette – mais aussi et surtout comme un acteur de son environnement naturel, domestiqué ou artificiel, en tenant compte des interactions écologiques que l’on retrouve dans ses habitats et en abordant également la possible signification mythologique ou symbolique de l’organisme ainsi que sa représentation dans les armoiries, les fables, les légendes et les contes de fées. Une approche aussi diversifiée pourrait révéler des choses plus essentielles sur cet « organisme » particulier qu’une observation sans vie en salle de classe.
2.3.2 Clairvoyance de la tête, du cœur (poitrine) et de l’abdomen
Si le monisme de Steiner est conçu pour rapprocher l’esprit et la matière (« parole » et « chair ») dans une approche différenciée et en même temps pénétrante, à perspectives multiples, alors il est plausible d’étendre la notion de « voir » au-delà de la vision conçue par l’œil sensible ou spirituel à d’autres zones physiologiquement sensibles. Une telle expansion est soutenue par l’usage quotidien du langage scientifique ou littéraire et par les recherches physiologiques récentes.
Dans une conférence donnée le 27 mars 1915 à Dornach aux membres de la Société anthroposophique dans le Johannesbau (qui était encore en construction à l’époque et qui est devenu plus tard le Goetheanum), Steiner a distingué trois formes de clairvoyance qu’il a attribuées à trois zones principales du corps : la tête, le cœur (la poitrine) et l’abdomen. Même si, dans cette conférence, il a brièvement mentionné le système indien des chakras et l’idée de « fleurs de lotus » (GA 161, 156), sa division tripartite de la clairvoyance entre les régions de la tête, du cœur/de la poitrine et de l’abdomen (ibid., 157) montre clairement la prédominance des idées occidentales dans la pensée théosophique et anthroposophique de Steiner, notamment en rapport avec la psychologie idéaliste platonicienne, que l’on retrouve aussi dans le modèle de la psyché de Sigmund Freud.
3.3.2.1 La clairvoyance liée à la tête
Pour introduire la conception de la « clairvoyance liée à la tête » (Kopf-Hellsehen), Steiner s’appuie sur la distinction entre les « anciennes » et les « nouvelles » formes de clairvoyance dans l’histoire des idées, en soulignant « que, dans un certain sens, c’est l’aspect clairvoyant de l’être humain qui doit générer des observations spirituelles et scientifiques qui puissent servir l’humanité actuelle dans le bon sens » (ibid., 155 f.). Car « le cycle de développement actuel de l’humanité [est] tel que les résultats réellement purs et authentiques de la science spirituelle ne peuvent être obtenus qu’en rendant notre activité psychique et mentale indépendante de la tête » (ibid., 155). Dans ce contexte, le concept déjà évoqué de « pensée surnaturelle », qui n’est pas dominée par le contenu de la perception sensorielle, est entendu dans un sens global (qui inclut une configuration spécifique de l’ego).
Le développement de la capacité de « clairvoyance liée à la tête » se concentre sur deux tâches, l’une négative et l’autre positive. La tâche négative consiste à libérer l’activité « spirituelle » et « psychique » – et les formes correspondantes de pensée, de volonté et de sentiment – de la domination des objets de la perception sensorielle. La deuxième tâche, positive, consiste à développer, découvrir et expérimenter systématiquement ces espaces d’activité « mentale » et « psychique » avec une conscience alerte et une pensée claire. Ce faisant, les individus peuvent établir des liens entre leurs pouvoirs mentaux et psychiques, qui sont désormais « libérés » des forces sensibles et (spirituelles) du cosmos (une dimension de la réalité explorée au moyen de l’« imagination morale » et par le biais de « pensées vivantes».
Steiner qualifie sans ambiguïté la « clairvoyance liée à la tête » de forme de « vision » mentale et imaginative : « la clairvoyance liée à la tête [est] davantage influencée par les pensées, transmises non seulement par des images mentales, mais aussi par des connaissances de nature sensible » (GA 161, 156 f.). Il est très intéressant d’examiner les verbes utilisés pour décrire l’idée de clairvoyance liée à la tête ; ils fonctionnent comme les modi operandi de Steiner pour décrire des chaînes d’associations et des relations factuelles en interaction. Relativiser la domination empirico-sensible dans le domaine spirituel de l’âme ne signifie pas que les idées ou les faits suprasensibles occupent et ravivent automatiquement l’espace désormais libre. C’est plutôt le cas dans le modèle de la « vieille » clairvoyance visionnaire et naturelle, qui est dans une certaine mesure involontaire. Dans la nouvelle forme de clairvoyance de Steiner, l’apparition d’idées, de concepts ou de faits suprasensibles est plutôt liée à une activité mentale qu’il décrit avec les verbes « soulever » ou « extraire ». Les découvertes de la recherche spirituelle, telles qu’elles sont recherchées dans l’étude théosophique ou anthroposophique de l’humanité, doivent être élaborées d’une manière spirituelle et scientifique (geisteswissenschaftlich), et elles doivent être « soulevées » ou « retirées » de leurs contraintes (c’est-à-dire par la pensée empirique dans les sciences traditionnelles [ibid., 156]).
On peut supposer que Steiner n’a pas choisi ses mots à la légère lorsqu’il a décrit son approche pédagogique de la science spirituelle pour mettre au jour la réalité psychique et spirituelle : le « moi », le « corps astral » et le « corps éthérique » (ibid.). Les verbes « soulever » et « extraire » renvoient à des images étonnamment similaires à celles de l’accouchement. En fait, Socrate, dont la mère était sage-femme, décrivait les processus cognitifs et éducatifs de la même manière. Le motif de la « naissance » résonne dans les réflexions de Steiner sur la clairvoyance, tout comme dans les écrits de Platon et dans certaines connotations piétistes du christianisme (par exemple, le motif d’une (re)naissance dans l’âme et l’esprit).
Une deuxième image métaphorique de la naissance, qui décrit la médiation entre un esprit « élevé » ou renaissant – un esprit imprégné de clairvoyance psychique et spirituelle – et les forces spirituelles du cosmos, ouvre une dimension intellectuelle complètement différente, mais tout aussi significative, de la pensée de Steiner, une dimension à la fois historiquement éclairante et spécifique. L’activité psychique et mentale, que Steiner caractérise comme un acte d’obstétrique spirituelle et scientifique, doit établir « une connexion spirituelle avec les forces du cosmos, comme si elle passait par un fil électrique » (ibid.). Dans cette citation, Steiner ne se réfère pas seulement à la méthode du magnétisme animal de Mesmer, mais utilise également sa formation scientifique et technique pour illustrer symboliquement les forces énergétiques (spirituelles) qui peuvent être libérées lorsque l’esprit et le cosmos sont connectés de manière productive par le biais d’un entraînement spirituel et scientifique de la clairvoyance liée à la tête.
Par rapport à d’autres formes de clairvoyance, Steiner définit la clairvoyance liée à la tête comme des représentations mentales dans un processus conscient et mentalement contrôlé qui aboutit à une connexion avec des entités cosmiques et les lois universelles du monde dans son ensemble. « Ce qui est atteint, lorsque la clairvoyance se produit de cette manière, c’est-à-dire qu’il s’agit pour ainsi dire d’une clairvoyance liée à la tête, peut être utilisé comme un résultat de la science spirituelle à notre époque ; car de tels [résultats] servent l’humanité » (ibid.).
3.3.2.2 La clairvoyance du cœur et de la poitrine
Dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, le renard confie son secret au Petit Prince : « C’est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. […] Les hommes ont oublié cette vérité ».
Pour vous qui aimez le Petit Prince, comme pour moi, rien au monde ne peut rester intact si quelque part – on ne sait où – un mouton qu’on ne connaît pas a mangé une rose ou peut-être ne l’a pas mangée […] Regardez le ciel. Demandez-vous : le mouton a-t-il mangé la fleur ou non ? Oui ou non ? Et vous verrez comment tout se transforme. […] Mais aucun adulte ne comprendra jamais que c’est si important !
36
Tout est transformé par le regard du cœur. La vision des choses de Saint-Exupéry, diffusée des centaines de millions de fois à travers le monde, appartient au bien commun de la culture mondiale et suggère que la pensée intentionnelle et rationnelle ne peut être le seul horizon dans lequel le sens et la signification du monde – de la pensée, des sentiments et des actions humaines – se révèlent. Le fait de limiter notre vision à un tel horizon obscurcit ou même étouffe l’essence de l’existence humaine.
Il n’est pas nécessaire de discuter et de décider ici si la thèse de Saint-Exupéry sur la vision transformatrice du cœur est basée sur un modèle connu, éventuellement biblique. Lorsque l’on compare cette idée de voir avec le cœur à celle de Steiner sur la « clairvoyance liée au cœur », il est pertinent de se référer à des sources littéraires. Cependant, pour une vision complète, nous devons également nous référer au contexte théologique et biblique qui sous-tend le thème du cœur en tant que siège de la compréhension. D’autant plus que la vision christique de Steiner, qui sera également abordée dans notre typologie ultérieurement, est aussi pertinente pour sa conception de la clairvoyance.
Dans la traduction de la Bible par la Société biblique allemande, près de cinq cents entrées, allant du premier livre de Moïse au livre de l’Apocalypse, peuvent être trouvées pour le mot « cœur ». Le « cœur » est en effet l’un des mots les plus fréquemment utilisés dans les Écritures. Formulé de manière abstraite, le cœur englobe les forces émotionnelles et les humeurs qui caractérisent l’attitude morale et éthique, en particulier nos bonnes et mauvaises intentions, nos sentiments, notre tempérament et notre caractère. Les auteurs bibliques font souvent la distinction entre les termes connexes de pensée, d’intelligence ou de sagesse. Paul parle d’un cœur « insensé » et « endurci » (Romains 1:21), et Pierre fait référence à un « cœur obéissant à la sagesse » (1 Pierre 1:22) et à un cœur « obscurci » ou « éclairé » (2 Pierre 1:19). Dans La Sagesse de Salomon, nous lisons que « la pensée est une étincelle allumée par les battements du cœur » (Sagesse 2:2). Paul, en particulier, souligne que le cœur, surtout en termes moraux, a le pouvoir d’initier la pensée et l’action ; il promet aux Gentils « que les exigences de la loi [de Dieu] sont écrites dans leur cœur » (Romains 2:15). Cette pensée initiée par le cœur pourrait même être étendue à la doctrine de Kant sur la loi morale et à la notion d’impératif catégorique en tant que disposition naturelle moralement raisonnable, ainsi qu’aux idées de Fichte sur « l’instinct moral et le sens naturel de la vérité ».
Tant sur le plan littéraire que théologique, la notion de « voir » avec le cœur – et même le concept de clairvoyance éclairée et tournée vers l’avenir – n’est pas une terra incognita. Et cela s’applique également à l’histoire récente de la philosophie. Les Lumières, par exemple, sont considérées non seulement comme l’époque où l’esprit a finalement dominé la foi aveugle et le dogmatisme, mais aussi comme une découverte de la sensibilité et du sentiment comme sources de conscience de soi et d’assurance. Johann Gottlieb Fichte, l’un des plus importants penseurs dans le domaine de la philosophie, a intégré cette « ambiguïté » des Lumières dans sa philosophie à un degré remarquable. Fichte était un philosophe qui a eu une influence profonde et considérable sur la formation et le développement de la pensée de Steiner. L’importance singulière que Steiner accordait à Fichte (en particulier dans son évaluation d’autres penseurs) ne peut être surestimée. Par exemple, Steiner tenait en haute estime le livre de Fichte intitulé La destination de l’homme (1800) et le recommandait même à ses amis. Dans La destination de l’homme, Fichte écrit :
L’homme n’est pas le produit du monde des sens, et le but ultime de son existence ne peut être atteint en lui. Ce but transcende le temps, l’espace et tout ce qui est sensible. […] Bien des gens ont été élevés dans cette optique sans formation artificielle à la pensée, uniquement par leur grand cœur et par leur instinct purement moral.
39
Fichte poursuit :
Quand je n’ai plus de cœur pour le monde éphémère, l’univers apparaît à mes yeux sous une forme transfigurée. […] [Ce] que je vois autour de moi est lié à moi ; tout est animé et plein de vie, et me regarde de ses yeux brillants et spirituels, et parle à mon cœur avec des sons spirituels.
40
Cette valorisation du cœur et des sentiments va de pair avec l’importance accordée à la pensée et à l’esprit. Fichte attribue cette correspondance au cœur et à « l’instinct moral », c’est-à-dire à une conscience spécifique de la vérité (à savoir un sens naturel de la vérité, un sentiment de la vérité) qui s’oppose à la « pensée formée artificiellement ». Dans le livre philosophique populaire de Fichte, L’Initiation à la vie bienheureuse (1806), qui était également important pour Steiner, on peut lire :
Ces conférences populaires […] expriment purement et simplement la vérité […] et comptent sur le consentement volontaire provenant du sens de la vérité. Cette présentation ne peut être prouvée ; mais elle doit être comprise. […] [Le sens de la vérité] suffit pour conduire à la connaissance de la vérité [.]
41
Ce qui est reflété ici dans l’œuvre de Fichte, et ce qui a influencé Steiner en conséquence, c’est le débat généralisé au siècle des Lumières sur la relation et les différences entre le cœur et l’esprit.
Si l’on se réfère à Steiner, l’approche philosophique de Fichte, l’approche littéraire de Saint-Exupéry et l’approche théologique de Paul pour développer une dimension de « voir avec le cœur » partagent l’idée que la connaissance du cœur change nos relations avec les personnes et les objets du monde. Les trois approches affirment également (comme déjà indiqué dans les citations ci-dessus) que le regard du cœur s’élève au-dessus du terrestre – et pas seulement intellectuellement, mais d’une manière immédiate, émotionnelle et pratique. L’univers entier est vécu d’une manière « totalement transformatrice » (Saint-Exupéry) et comme une « forme transfigurée » (Fichte), ce qui implique une « vocation pleine d’espoir » (Paul). Selon Steiner, le regard du cœur est un acte de médiation (émotionnel, volontaire et lié à l’action) qui relie le psychisme et l’esprit aux forces du cosmos et établit une « connexion spirituelle avec les forces du cosmos, comme par un fil électrique » (GA 161, 156).
Steiner aborde la différence spécifique entre la « clairvoyance liée au cœur/à la poitrine » et les deux autres modes de clairvoyance (clairvoyance liée à la tête et à l’abdomen) en particulier dans la huitième conférence de « Chemins de connaissance spirituelle » (Ibid., 155-173) en 1915. Ce que Steiner considère comme typique et caractéristique de la clairvoyance liée au cœur a déjà été décrit dans notre discussion sur Saint-Exupéry, Fichte et les sources bibliques, ainsi que dans nos références aux travaux de Mayer et Salovey sur l’intelligence émotionnelle et sociale. Comme cela a été souligné dans ce contexte, la « clairvoyance liée à la tête » chez Steiner ne consiste pas à se concentrer sur des idées ou des pensées et leur « caractère scientifique général » (ibid., 159), mais sur la maïeutique du psychisme et de l’esprit. Il explique que la clairvoyance liée à la tête se concentre sur le rôle du « cœur, des bras et des mains en tant qu’organes » de la cognition (ibid., 156), sur la « méditation […] qui se concentre sur la vie de la volonté », et sur la pratique éthique et morale. Ce concept de « méditation du cœur » n’est pas compris de manière métaphorique mais bien de manière réaliste comme un moyen de se connecter à « l’organe matériel du cœur » (ibid.). Le concept est issu de la pensée moniste de Steiner, qui unifie les dimensions du corps, de la psyché et de l’esprit.
La différence entre la « clairvoyance liée à la tête » et la « clairvoyance liée au cœur/à la poitrine » marque également les frontières des différentes sphères psychophysiques auxquelles se réfèrent les extensions de l’horizon mantique. Alors que la clairvoyance liée à la tête conduit principalement à contempler, reconnaître, percevoir dans les sphères […] moins importantes des mondes supérieurs – moins importantes […] dans le sens où la connaissance de ces mondes supérieurs est nécessaire pour la satisfaction de certains besoins cognitifs […] – la clairvoyance liée à la poitrine conduit davantage au développement de la volonté (ibid., 157).
Et tandis que la clairvoyance liée à la tête s’efforce plutôt d’établir une connexion spirituelle avec les forces du cosmos, « comme si elle passait par un fil électrique », la clairvoyance liée au cœur vise principalement à transformer notre culture de la perception et nos actions en tant qu’êtres humains, en particulier dans notre gestion éthique et affective de nos environnements naturels, sociaux et culturels. La perception clairvoyante joue également un rôle dans la perception des atmosphères (astrales) (appelées auras) des espaces sociaux et sociétaux. Selon Steiner, la clairvoyance liée au cœur peut, par exemple, remarquer la différence astrale entre un espace largement rempli de personnes mesquines et un autre dans lequel des personnes nobles sont présentes. Dans un hôpital, l’atmosphère physique mais aussi mentale est différente de celle d’une salle de danse. Une ville commerçante a une atmosphère astrale différente de celle d’une ville universitaire (TH, 169).
3.3.2.3 Clairvoyance liée à l’abdomen
Selon Steiner, un
troisième type de clairvoyance découle du fait qu’un relâchement du reste de l’être humain [la partie physiologique] peut entraîner l’élévation d’autres aspects, que nous pouvons appeler activité psychique et mentale. […] Peut-être pourrais-je appeler ce type de clairvoyance la « clairvoyance abdominale », même si cette expression n’est pas particulièrement esthétique. De cette façon, on peut vraiment distinguer la clairvoyance cérébrale, la clairvoyance thoracique et la clairvoyance abdominale (GA 161, 157).
La caractérisation de la clairvoyance liée à la tête et au cœur fait référence à l’activité psychique et mentale, qu’il s’agisse en premier lieu de « la place de l’homme dans le cosmos »
En médecine chinoise et en ayurveda, mais aussi chez Hippocrate, le tractus gastro-intestinal, son interaction avec le cerveau et son importance pour l’ensemble du corps, ainsi que pour la santé mentale, jouent un rôle central. Beaucoup considèrent le tractus gastro-intestinal comme un organe essentiel pour le diagnostic et le traitement des maladies et des dysfonctionnements de l’ensemble du complexe neuro-physio-psychologique. Au cours des dernières décennies, la médecine occidentale moderne s’est également de plus en plus intéressée au tractus gastro-intestinal.
Dans le domaine de la littérature, Voltaire a érigé un monument humoristique unique à ce thème dans le septième chapitre de son histoire Les Oreilles du comte de Chesterfield. L’un des protagonistes de l’histoire est Sidrac, le médecin personnel du comte. Il explique que non seulement les humeurs individuelles, mais aussi les grands événements de l’histoire du monde sont liés à une bonne ou mauvaise digestion. Dans une discussion philosophique sur les causes des actions humaines, Sidrac explique d’abord comment une mauvaise digestion, via le sang et la structure cellulaire, affecte les autres organes. Une mauvaise digestion affecterait en fin de compte l’humeur de l’esprit, influençant et orientant les actions humaines en général et celles des puissants en particulier. Cela prouve, selon Sidrac, que ni l’amour ni l’argent, mais plutôt une bonne selle matinale, détermine le destin de l’histoire du monde. Le médecin illustre cette thèse par de nombreux exemples historiques, notamment l’exécution de Charles I
Compte tenu de la vision populaire et littéraire de la signification de la physiologie humaine telle qu’elle est décrite ici, il n’est pas totalement absurde que Steiner non seulement intègre la nourriture spirituelle dans la pensée, le sentiment et la volonté, mais qu’il examine également le processus physiologique de la digestion chez l’homme d’un point de vue de clairvoyance afin d’en déterminer la signification pour l’activité psychique et mentale.
La première différence à prendre en compte est sémantique. Le texte de la conférence de la veille, donnée le 27 mars 1915, fait la distinction entre abdomen (Bauch) et estomac (Magen). Alors que le mot « estomac » dans ce contexte fait davantage référence aux processus physiologiques matériels de l’organe, le mot « abdomen » englobe un environnement sémantique plus large, qui inclut les processus émotionnels ainsi que ceux de l’ensemble du corps, en plus des aspects anatomiques et physiologiques liés aux organes. Ainsi, le concept de « clairvoyance liée à l’abdomen » élargit la notion étroite de l’estomac à celle qui considère l’ensemble du corps. Pour Steiner, cela implique une approche multidimensionnelle qui intègre les aspects psychiques et mentaux. La citation suivante illustre cette approche en utilisant l’exemple de l’absorption et de la digestion :
Lorsque vous avez mangé quelque chose, disons un morceau de navet – car nous sommes pour la plupart végétariens ici – et que cela est ensuite traité dans votre organisme, vous n’avez pas seulement affaire au processus physico-chimique que l’estomac effectue avec ses forces et ses sucs, mais derrière tout cela se trouvent les activités du corps éthérique, du corps astral
47 et du Je. Tous ces phénomènes ont des processus mentaux et spirituels derrière eux. Il serait tout à fait erroné de croire qu’il existe des processus matériels qui n’ont pas subi un processus spirituel (GA 161, 162).48
Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails des vues de Steiner sur les différents aspects physiques, psychiques et mentaux de la nature humaine (c’est-à-dire le corps astral, le corps éthérique, le moi, etc.), qui se rapportent en partie à des idées trouvées chez Platon, le néoplatonisme (Plotin), le piétisme (Jung-Stilling), l’idéalisme théosophique (Fichte) et la théosophie anglo-indienne (Blavatsky/Besant). Cependant, le monisme de Steiner est particulièrement soucieux – en particulier dans son anthropologie qui se réfère aux domaines physiques et matériels au sens strict – de clarifier et de mettre en évidence les éléments mentaux et spirituels constitutifs et déterminants de la clairvoyance abdominale. Dans cet état, il est possible « de voir tout ce travail, cette formation et cette création que l’activité psychique et mentale exerce sur les membres du corps pendant la digestion ; alors qu’elle se projette dans le monde, se reflétant dans des images, elle apparaît dans l’éther extérieur » (GA 161, 162).
Fondamentalement, le concept de clairvoyance abdominale de Steiner propose une approche qui n’est pas sans rapport avec les études psychosomatiques, la médecine holistique, ou la psychothérapie. Contrairement à ces méthodes, qui tendent à s’inscrire dans un cadre de sciences naturelles, Steiner s’intéresse principalement à l’étude de ces processus d’action et d’interaction d’un point de vue subjectif (c’est-à-dire en utilisant les processus d’exploration et d’expérience de soi pour traiter les processus anatomiques et physiologiques de son propre corps ainsi que son interprétation des contextes spirituel, mental et psychique). En raison de la systématique d’une anthropologie qui différencie l’intellect (ou l’esprit), l’âme et le corps, l’horizon de la recherche sur les processus physiologiques est limité à l’espace corporel individuel de l’expérience et des effets personnels. Le système de pensée de Steiner, qui repose sur l’universalité et l’objectivité, délimite la clairvoyance abdominale comme étant principalement de nature personnelle, limitant son importance par rapport à d’autres formes de clairvoyance, qui ont une perspective sociale et même cosmique. Pourtant, la clairvoyance abdominale reste une composante élémentaire de la conception de la clairvoyance dans son ensemble, en particulier en tant que domaine identifié phénoménologiquement et qui interagit avec les autres modes.
Dans le contexte de cette définition de la clairvoyance abdominale, Steiner semble vouloir se défendre contre une critique de la pensée anthroposophique : l’idée que la pensée anthroposophique tend vers des notions d’égoïsme salvateur et d’auto-rédemption. Car même dans les conférences de 1915, Steiner met l’accent sur les perspectives sociales et universalistes de la théosophie et de l’anthroposophie, qui dépassent les limites du perfectionnisme individualiste et qui ne peuvent se justifier par un nombrilisme spiritualiste. C’est précisément parce que
la clairvoyance liée à l’abdomen […] est généralement [… ] imprégnée de toutes sortes d’égoïsmes humains, [qu’]elle séduira facilement le clairvoyant égocentrique avec le fondement occulte de sa propre destinée […] avec le fondement occulte de sa valeur et de son caractère personnels (GA 161, 159).
Au lieu de cela :
chacun […] devrait être conscient de la manière dont une telle clairvoyance [inférieure] se rapporte à ce qui peut devenir une véritable clairvoyance spirituelle et de la manière dont il faut se garder de toute surestimation extérieure obtenue par des moyens clairvoyants de telle sorte qu’elle ne puisse avoir qu’une signification personnelle » (ibid., 163).
Et, pour en venir au point final, il dit : « Tout comme on ne peut pas résoudre les mystères du monde en examinant la digestion humaine, on ne peut pas se rapprocher des mystères et des secrets du monde en développant la clairvoyance abdominale » (ibid., 159).
Cependant, le danger de surestimer « ce que l’on gagne par la clairvoyance abdominale » (ibid.) est dû non seulement à la prédominance de l’espace d’expérience physique et sensible en tant que domaine principal de l’expérience de soi et du monde, mais aussi à l’intensité sensible associée aux phénomènes qui se produisent par la clairvoyance abdominale. Steiner conclut que cette clairvoyance est directement liée aux processus physiologiques du corps, ce qui explique sa forte affinité avec le sensible. En prenant l’exemple de l’intensité des couleurs et des sons, Steiner tente d’illustrer que, dans le développement de la clairvoyance, depuis la clairvoyance liée à l’abdomen, qui est liée au corps physique, jusqu’à la clairvoyance purement mentale, liée à la tête, l’intensité des couleurs et des sons s’affaiblit et les éléments incolores augmentent : Ce n’est qu’après l’affaiblissement du spectre matériel des couleurs et des sons que les couleurs ésotériques et les harmonies sonores du monde spirituel-cosmique deviennent audibles (ibid., 159-161). Ici aussi, le modèle moniste de Steiner, qui pénètre, entremêle et différencie à la fois le monde matériel et les sphères de l’activité psychique et mentale, est à nouveau évident.
2.4 Clairvoyance et christologie
L’un des rares domaines de l’anthroposophie que la science académique a abordé à plus grande échelle – et ce dès l’époque de Steiner – est celui de la christologie. Les enseignements de Steiner sur le Christ ésotérique et sa signification pour l’évolution de l’histoire cosmique, humaine et individuelle ont suscité un grand nombre de critiques, principalement théologiques, du « nouveau christianisme » développé et représenté par l’anthroposophie. Cela s’est produit en particulier pendant la crise idéologique du début du XXe siècle. Steiner a joué à cette époque le rôle de « sismographe du déficit des Églises chrétiennes établies et de leur clientèle principalement protestante ».
Georg Scherer a résumé ce fait en 1987 de manière brève et extrêmement condensée lorsqu’il a affirmé que dans le « dernier Steiner », la métamorphose de Jésus de Nazareth en Jésus-Christ, le mystère du Golgotha et le devenir de l’homme sont étroitement liés. Cet événement est le véritable sens de la phase actuelle de développement de la terre dans laquelle nous nous trouvons. C’est pourquoi, d’un point de vue anthroposophique, le Christ Jésus est le point central de l’histoire de la terre.
Steiner lui-même affirme : « L’époque de développement décisive dans l’évolution de l’expérience humaine du moi est celle où s’est produit le mystère du Golgotha » (GA 25, 56). Mais ce n’est pas tout. L’« impulsion christique » et le « mystère du Golgotha » sont étroitement liés à la signification et au but d’une interprétation christologique des processus anthropogénétique et cosmogonique (ibid., 61).
Steiner a considéré comme un fait que sur terre, Jésus a travaillé en tant que « maître du monde et personnage de pouvoir » (GA 152, 120) en pensant, enseignant et agissant en communion avec l’esprit et la puissance de Dieu. Ce qui intéresse Steiner, c’est la manière dont les êtres humains individuels et terrestres participent à cet esprit et à cette puissance. La réponse à cette question ramène à l’étude de la différence entre les « anciennes » formes naturelles, visionnaires et non intellectuelles de la clairvoyance et le concept d’une « nouvelle » clairvoyance consciente et basée sur la pensée. Deux autres aspects qui affectent cette étude sont (a) le rôle constitutif du « je » dans cette forme de cognition et (b) le mode de clairvoyance associé au cœur en tant que dimension de la conception de Steiner d’une connaissance qui informe et guide les aspects volontaires, éthiques des êtres humains. Selon Steiner, depuis « l’événement du Golgotha » (c’est-à-dire l’incarnation universelle, historique et personnelle de Dieu), il existe une possibilité certaine que même les êtres humains modernes, vivant dans un monde désenchanté et profane, puissent, « en unifiant la conscience ordinaire éveillée avec l’être [du Christ] et en contemplant les actes du Christ, retrouver après l’événement du Golgotha ce qu’ils avaient auparavant trouvé grâce à une disposition naturelle de leur conscience » (GA 25, 57). L’esprit de la Pentecôte, ou « langue de feu », n’est donc « rien d’autre que le réveil du Christ intérieur dans l’âme de ses étudiants, dans l’âme de ses disciples » (GA 226, 97). Et ce « réveil » est une reconnaissance intérieure et une prise de conscience du « Christ comme guide […] avec un sentiment vivant » (GA 25, 78), une capacité à intégrer « des qualités morales dans un monde amoral » tout en « admirant les actes du Christ » (ibid.). Elle permet aux individus d’adopter librement son « être de valeur morale et spirituelle » (moralischgeistiges Wertwesen) et de devenir le « créateur » de leur propre destin et un co-créateur du destin de l’humanité (ibid., 86 f.).
Dans la perspective de la conception de la clairvoyance de Steiner et de son évolution historique, nous touchons ici au tournant unique de la « vieille » à la « nouvelle » clairvoyance, qui est un moment décisif dans le développement de l’individu et de l’humanité ainsi que dans l’histoire du monde. Ce moment marque la transition vers un nouveau mode de clairvoyance, libre et éclairé, qui a également une dimension éthique.
Même si Zander se réfère à juste titre aux travaux de Stieglitz pour prouver que la christologie de Steiner est « une vision du monde spéculative et fortuite »
3. Développement historique du thème de la clairvoyance chez Steiner
En retraçant le concept d’« intuition morale » depuis la Philosophie de la liberté (1894) jusqu’aux conférences de Steiner sur la formation et l’initiation mystiques au début des années 1900 avec l’ouvrage Comment acquérir des connaissances sur les mondes spirituels, nous avons tenté de relier les idées philosophiques dominantes et les phases théosophiques et anthroposophiques ultérieures de la pensée de Steiner. Cela a été possible grâce à l’intérêt pour l’ésotérisme déjà présent chez le « jeune Steiner », d’une part, et à la poursuite dominante du motif de la « pensée » dans les différents modèles de clairvoyance au cours de ces phases, d’autre part.
De la thématisation explicite et systématique de la clairvoyance au début du XXe siècle jusqu’aux dernières conférences de Steiner au milieu des années 1920, il différencie et modifie clairement son approche du sujet. Cette évolution devrait être examinée plus en profondeur, tant en ce qui concerne l’origine de ses idées que leur influence sur ses principaux écrits théosophiques et anthroposophiques.
C’est avec raison que l’on peut faire remonter le début de l’examen explicite du sujet de la clairvoyance par Steiner à 1904 (c’est-à-dire à la période de ses premières publications dans la revue Lucifer-Gnosis et de ses livres Comment acquérir des connaissances sur les mondes spirituels, Théosophie et La Chronique de l’Akasha). Une deuxième phase peut être liée à l’étude intensive des premiers cultes mystérieux de l’Antiquité par Steiner en 1909, notamment sous l’influence du livre d’Edouard Schuré Les Grands Initiés, et à la création ultérieure de ses Drames-Mystères de 1910 à 1913. Cette période a également été marquée par une confrontation avec la Société théosophique et son développement spirituel et politique. Une troisième phase s’est déroulée entre 1913 et 1915 environ, qui couvre la fondation de la Société anthroposophique et la construction du Goetheanum à Dornach. Enfin, on peut parler d’une quatrième phase mystique chez Steiner après 1920 (c’est-à-dire la période de consolidation et d’expansion de l’anthroposophie dans les domaines dits pratiques). L’affinement de la christologie et de la théologie de Steiner, en conflit avec la compréhension traditionnelle de la foi dans les religions établies, a peut-être joué un rôle particulier à cet égard.
Au premier plan de la première phase – dans le cadre de la dichotomie nature/art – nous voyons d’une part une relativisation de la clairvoyance en tant que don de voyance naturel et d’autre part une mise en avant de la clairvoyance en tant qu’art d’initier et d’éduquer (GU, 4 ; SKA 8,1, 217), ou en d’autres termes, en tant qu’entraînement systématique à des compétences particulières, telles que des exercices de méditation ou de pleine conscience. Cette compréhension de la clairvoyance en tant que compétence est particulièrement importante dans la présentation des « organes de clairvoyance » (Hellseherorgane ; WE, 33 ; SKA 7, 39) à travers une série de huit exercices pour le développement spirituel, qui sont combinés dans Comment acquérir des connaissances sur les mondes spirituels avec des descriptions de certaines perceptions du son, de la couleur, de la température et de la forme associées à ces organes (ibid. : 112-160 ; ibid. : 88-117). Dans la deuxième phase du développement de la clairvoyance chez Steiner, l’accent est mis sur l’élaboration de la différence entre les « anciennes » formes naturelles de clairvoyance et la « nouvelle » forme centrée sur le moi et entièrement fondée sur la pensée (qu’il qualifie de non sensible).
4. Une perspective d’ensemble pour conclure
Il est certainement vrai, comme le soulignent les recherches critiques, que le cheminement de Steiner vers la théosophie et le développement de sa « propre » pensée ne peuvent être suffisamment compris, discutés avec pertinence ou même jugés en dehors du contexte des débats culturels de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Cependant, ce point s’applique de manière générale à la compréhension de tous les grands et petits esprits de l’histoire qui ont trouvé ou trouveront leur place dans le discours scientifique actuel. Une telle contextualisation historique et intellectuelle ne peut toutefois pas régler la question de la signification et de l’importance des positions en question. L’explication des contextes historiques, sociaux ou biographiques à l’origine d’une certaine position ou d’un certain enseignement scientifique ou idéologique ne fournit que des informations limitées sur son importance dans l’histoire des idées. À cet égard, l’étude approfondie de modes de connaissance alternatifs ne peut pas, ou du moins seulement de manière limitée, se faire en s’appuyant sur les méthodes historiques et l’histoire des sciences. D’autres questions, complètement différentes, concernent le sens et la cohérence interne d’un modèle de pensée, ainsi que le degré d’impulsions créatives pouvant être obtenues à partir de son examen critique. Un sujet aussi provocateur que la clairvoyance dans l’œuvre de Rudolf Steiner soulève de manière exemplaire les questions de la perspective et de la multiperspective, ainsi que de la mythologisation, de la démythologisation et de la remythologisation des discours, amenant les chercheurs à réexaminer et à réévaluer les possibilités et les limites d’une restitution ontologique existentielle de la pensée métaphysique (Janke).