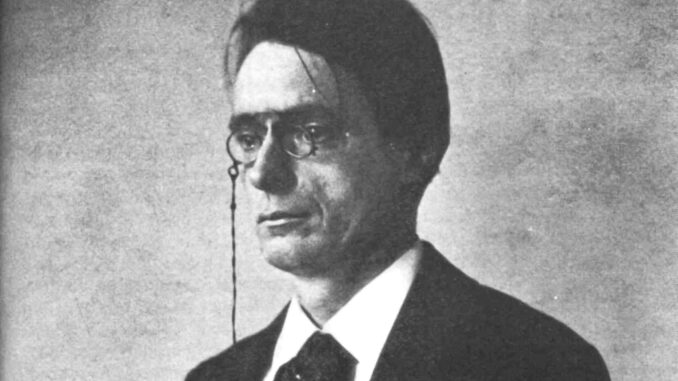
Traduction intégrale d’un article de Marcelo da Veiga et Hartmut Traub paru en 2024 dans la revue Steiner Studies, Volume 4. DOI:https://doi.org/10.12857/STS.951000440-15. Licence : CC BY 4.0.
Titre original : What does ‘Steiner Research’ actually mean? A First Step towards Clarification
Les grandes lignes des Steiner Studies
Il existe en philosophie, comme en littérature et en histoire de l’art, la particularité de rapporter la recherche à des auteurs ou à des personnes. On parle par exemple d’une recherche sur Aristote, d’une recherche sur Fichte, d’une recherche sur Heidegger ou, dans d’autres disciplines, d’une recherche sur Borges, d’une recherche sur Goethe ou d’une recherche sur Rubens. Dans ce sens, on parle aussi depuis peu d’une recherche sur Steiner (Steiner Studies). Cette expression s’est imposée dans le cadre de la réalisation de l’édition critique des écrits de Rudolf Steiner (SKA) aux éditions frommann-holzboog et n’existait pas auparavant, car Steiner ─ à quelques exceptions près ─ n’a guère été reçu sur le plan académique et philosophique. Aujourd’hui encore, c’est plutôt l’exception. Avec les progrès de la SKA, l’établissement de cursus universitaires en lien avec l’anthroposophie et les premières revues scientifiques à comité de lecture comme RoSE (Research on Steiner Education) et les Steiner Studies, une nouvelle dynamique a vu le jour.
Pour les Steiner Studies en particulier, il vaut la peine de réfléchir à ce que l’on entend ou pourrait entendre par un projet de recherche sur Steiner, non seulement en général, mais aussi au sens plus étroit, et aux questions et champs thématiques qui se présentent.
Des sources de recherche fiables
Dans les écrits de Steiner, on trouve les études ou les présentations les plus diverses sur des thèmes et des questions spécifiques, comme la théorie de la connaissance, l’éthique, la littérature et l’art, mais aussi le développement spirituel de l’homme, la méditation, le contenu et la signification des traditions mythologiques et religieuses ainsi que des considérations ésotériques sur l’histoire du cosmos et de l’humanité.
Outre les écrits de Steiner, il existe également une œuvre considérable de conférences dans lesquelles Steiner s’est exprimé sur une multitude et une diversité de thèmes presque incalculables. Les plus connus et les plus influents sont les exposés sur la pédagogie, la médecine ou l’agriculture, sur l’enseignement du karma ou sur l’art et l’eurythmie. Aux textes écrits et aux conférences s’ajoutent des lettres, des anecdotes et la pratique ou les théories de ceux qui se réfèrent à Steiner pour leurs actions dans ce que l’on appelle les champs pratiques1. Par ailleurs, il convient de mentionner le travail de Steiner dans le domaine des arts plastiques, qui n’a guère été pris en compte jusqu’à présent2. Il s’agit de l’œuvre picturale, graphique et architecturale de Steiner.
Ce qui est remarquable dans la réception de Steiner depuis plus d’un siècle, c’est que les thèmes les plus souvent associés à Steiner ne proviennent pas de son œuvre littéraire au sens strict, mais qu’ils s’appuient surtout sur ses conférences, c’est-à-dire sur les transcriptions de cycles de conférences ou les procès-verbaux de mémoire des participants, qui ne sont que partiellement autorisés par Steiner.
La divergence des sources de la ‘succession écrite’ de Steiner ainsi que les différents champs thématiques qui y sont liés ne sont souvent pas suffisamment distingués dans les commentaires de son enseignement quant à leur pertinence systématique ou contextuelle, ni classés dans l’histoire de l’œuvre ou pondérés systématiquement. Tout ce qui a été transmis d’une manière ou d’une autre par écrit est souvent utilisé de manière indifférenciée selon le contexte d’écriture et l’intérêt du moment.
Afin de pouvoir déterminer le champ de la recherche sur Steiner de manière objective et appropriée, il est cependant utile, voire nécessaire, de garder à l’esprit les différences entre les genres de textes et les sources.
Les sources les plus fiables pour les débuts de la recherche sur Steiner, dans la mesure où il s’agit des enseignements centraux, sont les textes originaux. En effet, c’est à travers eux que Steiner, en tant qu’auteur, s’adresse publiquement à un public général pour exposer des idées et des points de vue qui lui semblent pertinents. On peut également compter parmi ces sources les essais, les conférences qu’il a rédigés lui-même ou publiés sous la forme d’un exposé d’auteur. Là aussi, il faut partir du principe qu’il s’agit de déclarations originales destinées à un public général. Les recherches sur Steiner qui se réfèrent à ces sources ont une base solide. Et c’est ainsi que l’on peut dire aujourd’hui que le SKA constitue cette base fiable pour une recherche sérieuse sur Steiner3.
Distinguer la recherche de Steiner et la recherche sur Steiner
Le contenu central des écrits de Steiner est ce qu’il a d’abord appelé « science spirituelle » au sens noologique4, puis « théosophie », « science occulte » et enfin « anthroposophie »5. Pour Steiner, ces termes désignent et décrivent une science empirique (expérientielle) de l’esprit comparable aux sciences naturelles. Outre les questions philosophiques et littéraires, cette approche aborde également des thèmes spirituels et ésotériques, tels que l’idée de réincarnation, les processus anthropogénétiques et cosmogénétiques, etc.
Dans le sens de l’anthroposophie de Steiner, les contenus et les phénomènes décrits et discutés par l’auteur sont le résultat d’une méthode rationnelle spirituelle, mais également empirique. Cela signifie qu’ils ne reposent pas – comme la théosophie classique, par exemple – sur une simple reprise de méthodes, de théorèmes ou de contenus choisis de visions du monde et de traditions ésotériques, philosophiques ou religieuses. Ils ne sont pas non plus conçus comme une simple justification d’une vision du monde divergente, puisque Steiner les a conçus dans le sens de son propre monisme, c’est-à-dire d’une façon complémentaire aux résultats de la conception matérialiste (naturelle) de la science.
Face à de tels contenus et méthodes anthroposophiques, dont les prétentions sont scientifiques mais qui incluent le « suprasensible » et l’ésotérique, on peut naturellement objecter qu’il n’est pas possible d’atteindre un savoir solide sur les faits et les liens métaphysiques ou psychologiques en question. C’est notamment le cas lorsqu’il est fait appel à une certaine perspective épistémologique et à ses prémisses méthodologiques – par exemple en s’appuyant sur Locke, Hume ou Kant. Par conséquent, la méthode de l’« empirisme spirituel » ne serait pas un instrument approprié pour acquérir et étayer un savoir empirique fiable et généralement vérifiable. Cependant, il faut d’abord admettre que l’anthroposophie, à supposer que sa perspective soit possible, a été méthodologiquement conçue, développée, représentée et appliquée par Steiner sur cette base. Dans cette perspective, la recherche anthroposophique ne se fonde pas sur l’exégèse textuelle, mais sur la découverte pratique et méditative, sur l’analyse réflexive et sur l’exploration intérieure et attentive de la conscience.
Cependant, la lecture, l’étude et l’interprétation d’écrits philosophiques, théologiques, scientifiques et ésotériques, ainsi que la connaissance du contexte des sciences naturelles, au sens étroit du terme, jouent également un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer. Ils sont importants pour approfondir la compréhension de la genèse et des contextes ou comme recommandation pour la formation de la pensée anthroposophique. Cependant, la recherche anthroposophique est essentiellement axée sur l’étude rationnelle, empirique et orientée vers l’application des phénomènes du monde de l’esprit ou de l’âme. La compréhension de leur évolution historique et de leur impact culturel a pour but de contribuer au développement social et individuel d’une humanité globale.
Ce concept de recherche anthroposophique doit être distingué de la recherche sur Steiner dans le sens d’un projet plus neutre de recherche et de discours académique et scientifique qui s’applique à la vie, à l’œuvre et à l’influence historique de Rudolf Steiner, ainsi qu’au mouvement anthroposophique qu’il a fondé et qui suit son enseignement.
Malgré cette différence dans l’attitude de recherche, nous estimons qu’il est possible de discuter et de contribuer de manière critique et significative à ce qui est important pour l’approche anthroposophique en termes de contenu et de méthode, ainsi qu’en termes d’histoire des idées. L’histoire des sciences du 20e siècle, de Husserl à Sloterdijk, de Heidegger à Hanegraaff, en est un bon exemple.
Anthroposophie et philosophie
Dans ce contexte, une autre différence épistémologique doit être abordée de manière critique. Il est vrai que l’anthroposophie ne peut pas être simplement comprise comme une philosophie au sens habituel du terme, c’est-à-dire comme une recherche de la connaissance de la réalité par le biais de la pensée conceptuelle, comme une étude comparative de l’histoire de la philosophie ou comme une analyse et une clarification de concepts et d’arguments6.
A cet égard, une distinction entre philosophie et anthroposophie est certainement plausible. Néanmoins, la pensée analytique, philosophique et historique est une composante essentielle et indispensable de l’anthroposophie. Elles contribuent toutes deux au chemin de la connaissance spirituelle en invitant à la réflexion, à l’examen et à l’interprétation des faits, des structures, des processus et des liens ainsi découverts, et elles aident à les contextualiser de manière appropriée dans l’histoire de la pensée et de la conscience humaines.
Domaines de recherche
L’esquisse suivante des champs thématiques possibles de la recherche critique7 sur Steiner et l’anthroposophie n’a pas la prétention d’être complète, encore moins exhaustive. Elle a pour but d’inciter à une réflexion plus approfondie et d’ouvrir un dialogue sur ce que pourraient être les contenus et les contextes d’une recherche sur Steiner sérieuse.
Transformations et contextes inhérents au travail
Le premier domaine d’un éventuel cadre de recherche sur Steiner devrait se référer à ce qui est dit et signifié dans les textes/écrits primaires de Steiner et à ce qui est, pour ainsi dire, le contenu essentiel de la pensée de Steiner en général. Cette perspective n’est pas anodine, non seulement parce que les sources écrites mentionnées ci-dessus sont souvent traitées sans conscience critique de la qualité du texte, mais surtout en raison des ambiguïtés linguistiques et des variations dans les textes primaires que l’on peut observer au cours du développement de la pensée de Steiner. Cette transformation nécessite une exploration et une évaluation herméneutique et contextuelle des termes et expressions de son œuvre. En effet, certains termes significatifs sont utilisés par Steiner dans des nuances et des contextes très différents.
Par exemple, l’« intuition » est un concept central de la pensée de Steiner. Il est utilisé dans l’Épistémologie de la vision du monde de Goethe (1886) et la Philosophie de la liberté (1893), ainsi que dans l’Esquisse d’une science occulte (1910). Pour analyser le terme « intuition », il faudrait donc non seulement clarifier le sens dans lequel il est utilisé et son contexte intellectuel, mais aussi les contextes auxquels il se réfère. S’agit-il de signifier des choses différentes, des choses similaires, voire la même chose dans des contextes différents ? En d’autres termes, la discussion et la clarification des concepts, de leurs significations et de leurs transformations sémantiques sont une condition préalable et indispensable à une discussion appropriée des sujets traités par Steiner, que ce soit dans le détail ou dans un sens général. En outre, la question déjà soulevée des différences et des liens entre les périodes explicitement anthroposophiques et les périodes pré- ou implicitement anthroposophiques de la pensée de Steiner appartient à ce champ de recherche et de transformation.
Approches herméneutiques
Un autre domaine concerne la discussion sur le type d’herméneutique qu’il convient d’appliquer à la pensée et à l’œuvre de Steiner. Cela comprend les questions herméneutiques et heuristiques du genre, de la situation, de la structure, de la référence, des prétentions à la validité, ainsi que de l’accès logique, esthétique et performatif à son œuvre. Si, par exemple, la deuxième édition de la Philosophie de la liberté est sous-titrée « Résultats de l’observation de l’âme selon la méthode des sciences naturelles », et que la préface de cette même édition souligne que la Philosophie de la liberté ne transmet aucune information fixe, mais encourage plutôt l’observation autonome, cela a nécessairement des conséquences herméneutiques sur le développement, la discussion et l’évaluation du texte. Apparemment, l’auteur n’a pas l’intention de transmettre une théorie, mais plutôt de présenter les résultats d’une phénoménologie de la conscience. Il faut donc se demander si la discussion doit porter sur la performance ou la logique, la méthode ou le contenu, ou les deux, et si oui, dans quelle mesure et avec quelle prétention à la validité. S’agit-il d’un texte théorique avec des instructions pour des exercices ou de déclarations symboliques ou littérales ? L’approche critique et herméneutique de l’œuvre de Steiner peut être la clé d’une compréhension appropriée.
Contexte intellectuel, biographique et contemporain
Il ressort clairement des écrits et de la biographie de Steiner – cette dernière fournit suffisamment de matière à la recherche – qu’il s’est beaucoup intéressé à des écrivains tels que Herbart, Goethe, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Stirner, ainsi qu’aux principaux intellectuels de son époque, comme Nietzsche, von Hartmann, Haeckel et Schuré. En outre, il connaissait l’héritage des idées littéraires, mystiques, philosophiques et scientifiques de l’histoire intellectuelle européenne dans son ensemble, ainsi que de nombreux aspects de l’ancienne sagesse indienne. De plus, la vie et l’œuvre de Steiner étaient intégrées dans les courants scientifiques, politiques, idéologiques, sociaux et culturels de l’époque. Pour contextualiser et classer son œuvre, il est donc essentiel de prendre en compte les développements académiques, sociaux et politiques de son époque.
Il s’agit notamment des conceptions biologiques de la race et de l’eugénisme fondées par Darwin et approfondies par Haeckel, mais aussi de la perte des repères à l’époque du nihilisme et de la décadence, déclenchée initialement par Nietzsche et approfondie après la Première Guerre mondiale. La question qui se pose est la suivante : dans quelle mesure Steiner a-t-il été influencé, directement ou indirectement, par ce contexte idéologique et la pensée contemporaine ? Par conséquent, dans quelle mesure son travail doit-il être contextualisé afin d’éviter des interprétations erronées de sa terminologie ou des écoles de pensée contemporaines.
Un aspect particulier de la contextualisation concerne également la biographie de Steiner elle-même. Les biographies de Steiner par Lindenberg, Zander et Hoffmann ont dans l’ensemble clarifié les étapes les plus importantes de la vie de Steiner. Cependant, de nombreuses questions restent encore en suspens, notamment en ce qui concerne certains points clés de sa biographie éducative. Quelle a été l’influence de l’herboriste Zimmermann sur les études de Steiner à Vienne, qui l’a initié à l’idée de l’anthroposophie vers 1880 ? Parmi les sujets peu étudiés et pourtant importants de sa biographie éducative, au début, au milieu et à la fin de sa vie, on peut citer : Steiner et le néo-kantianisme, sa relation avec E. v. Hartmann ou avec Haeckel, Nietzsche et Schuré, ainsi que ses ambitions pédagogiques et ses réflexions éducatives lors de son séjour à Berlin. En outre, les liens et les différences entre les principaux ouvrages ésotériques de Steiner et les ouvrages thématiques des cercles autour de Blavatsky, Besant et d’autres théosophes ne sont pas correctement étudiés, documentés et classés en termes d’impact sur son travail.
Enfin, il y avait dans l’entourage de Steiner des collaborateurs et des compagnons dont l’influence sur les idées et les développements de sa pensée doit être étudiée et prise en compte pour éviter de mystifier Steiner en tant que figure ésotérique solitaire. Citons par exemple l’influence d’Ita Wegmann sur le développement de la médecine anthroposophique et celle de Marie von Sievers sur le développement de l’eurythmie.
Possibilité et voies d’accès à la connaissance suprasensible
Une question fondamentale concerne la possibilité d’une connaissance spirituelle ou suprasensible autonome développée selon les principes spécifiques postulés par Steiner. Son œuvre contient par exemple des déclarations sur l’évolution cosmologique ou sur le travail de certains initiés ou d’êtres supérieurs, et bien d’autres choses encore, qui prétendent être le résultat d’une recherche spirituelle autonome. Il ne s’agit pas ici de citations ou de paraphrases d’anciens textes religieux, ni de résultats de conclusions ou de spéculations philosophiques, et encore moins de fiction, c’est-à-dire de produits de la simple fantaisie ou de l’imagination. Au contraire, Steiner prétend avoir (re)découvert un chemin de développement intérieur qui permet d’acquérir la capacité d’observer les faits spirituels.
Selon lui, il est possible de connaître ces phénomènes de manière indépendante et fiable, tout comme il est possible d’observer et de décrire des réalités physiques, telles que l’existence des ours polaires. Certes, cette affirmation n’est pas nouvelle. En effet, elle s’applique également à la pensée indienne pré-européenne, au gnosticisme et au mysticisme européens, ainsi qu’à la tradition philosophique à laquelle Steiner fait principalement appel8. Une analyse et une discussion philosophiques sur les possibilités et les limites de la connaissance suprasensible et sur la question de savoir si et comment l’approche anthroposophique de Steiner est liée à ces traditions ─ par exemple aux méthodes de la Brahmavidyia de l’Inde ancienne ─ ou si elle s’en différencie dans le détail, ont été jusqu’à présent littéralement inexistantes.
Impact historique
Un autre domaine de recherche concerne l’histoire de l’influence de Steiner. Il s’agit d’une part de l’influence positive sur d’autres penseurs, hommes politiques, auteurs ou artistes (Joseph Beuys en est peut-être l’exemple le plus marquant), et d’autre part du rejet et de l’histoire polémique de la réception de la pensée de Steiner. Ce type de recherches et d’analyses porte moins sur la véracité des faits ou des idées exposés par Steiner lui-même que sur leur transformation, leur impact et leur influence du point de vue des intentions et des arrière-plans de ces polémiques. Dans ce contexte, il n’est pas anodin de se demander si les adaptations et les impacts découlent objectivement de l’œuvre de Steiner ou s’ils y sont simplement associés subjectivement. Un champ de recherche lié au problème de l’histoire de l’influence de Steiner s’étend à l’étude des « domaines pratiques » de l’anthroposophie et de leur lien avec le contenu et la signification des idées centrales de sa science de l’esprit.
Société anthroposophique et mouvement anthroposophique
Un autre domaine de recherche sur Steiner est l’étude du mouvement anthroposophique et de la société anthroposophique, de son évolution historique, actuelle et future, en particulier dans les conditions changeantes de communication et d’interaction de l’internationalisation, de la globalisation et de la digitalisation. Des questions sur le passage d’une « culture mondiale » plutôt eurocentrique à une « culture mondiale » universaliste, ou sur les adaptations, transformations et interprétations de l’anthroposophie dans différents contextes culturels pourraient également être pertinentes.
Notes
- Par exemple, dans les institutions de pédagogie curative du mouvement Camphill, on pratique la lecture régulière de la Bible. Par ailleurs, certaines écoles Waldorf cultivent une proximité avec la communauté des chrétiens. Cette pratique n’est pas critiquée ici, mais elle ne découle pas de la pédagogie Steiner en tant que telle et n’en est pas constitutive, mais repose sur des décisions personnelles dans certaines institutions.
- Les grandes expositions consacrées aux dessins de Steiner dans différents musées renommés constituent une exception.
- L’orientation vers la méthode historico-critique dans l’édition des œuvres de Steiner se manifeste également dans la révision actuelle des volumes de l’édition complète Rudolf Steiner, commencée au milieu des années 1950 et publiée par Rudolf Steiner-Verlag, Dornach.
- En philosophie, relatif à la pensée, à l’esprit humain
- Le terme « anthroposophie » utilisé par Steiner pour désigner son enseignement pose, en tant que sujet de recherche contextuel et critique, la question de son origine et de sa signification systématiques dans l’histoire des idées. Il s’agit, d’une part, du problème de l’utilisation légitime de ce terme pour des ouvrages écrits avant la fondation de la Société anthroposophique (1912/13) et l’introduction de l’enseignement de Steiner en tant qu’anthroposophie, et, d’autre part, du lien théorique et conceptuel entre les phases pré-anthroposophiques et les phases explicitement anthroposophiques de la pensée de Steiner.
- Cette conception de la philosophie est déjà une conception spécifiquement moderne de l’essence de la philosophie, que Steiner lui-même a partiellement défendue. Cela se traduit notamment par le fait que cette conception et ce mode d’argumentation (ou cette vision logocentrique) ne peuvent pas être entièrement conciliés avec la compréhension de la philosophie de Platon ou de Spinoza, Fichte, Husserl, Wittgenstein, James ou Taylor. Ces penseurs ont représenté et représentent toujours une conception plus large de la philosophie, dans laquelle la pensée conceptuelle ne constitue qu’une partie, bien qu’essentielle, d’une cognition complète. Elle correspond à une vision plus globale et à une conviction philosophique basée sur cette dernière.
- De notre point de vue, la recherche critique n’est ni une approbation ni un rejet des idées de Steiner sur la base de présupposés. Il s’agit avant tout d’une approche différenciée de leur développement et de leur discussion, qui est également capable de réfléchir à son propre point de vue méthodologique et aux hypothèses qui le sous-tendent. Cf. Nagel. (1989).
- La redécouverte des études religieuses de James (1902) et Taylor (2002), basées sur l’expérience, montre que le thème de la « réalité du suprasensible » continue d’être abordé dans les discussions actuelles en sciences humaines.