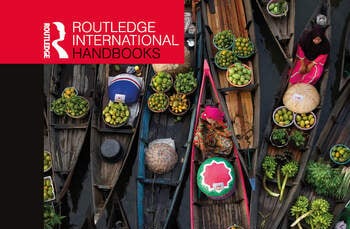
Résumé d’un article de l’anthropologue Clelia Viecelli intitulé « La biodynamie en tant que patrimoine culturel : entre l’héritage de Steiner et les enjeux contemporains » paru en septembre 2025 dans le livre Routledge Handbook of Food and Cultural Heritage. DOI : https://doi.org/10.4324/9781032026565-7
Titre original : Biodynamics as Cultural Heritage. Between Steiner’s legacy and contemporary issues
Clelia Viecelli est anthropologue et responsable du programme Alimentation, durabilité et environnement à l’Institut Umbra de Pérouse (Italie). Elle explore dans cet article les relations entre l’agriculture biodynamique, ses fondements philosophiques et les débats contemporains sur le patrimoine culturel. La biodynamie, née en 1924 lors du « Cours d’agriculture » donné par Steiner à Koberwitz, est aujourd’hui pratiquée dans plus de 60 pays. Elle se distingue de l’agriculture biologique par une dimension spirituelle et cosmologique héritée de l’anthroposophie : la ferme y est conçue comme un organisme vivant en interaction avec les forces terrestres et cosmiques. Les préparations biodynamiques (bouse et silice de corne, composts dynamisés par des plantes médicinales), l’usage de calendriers lunaires et l’attention particulière portée au vivant dans toutes ses manifestations traduisent cette vision holistique.
Viecelli rappelle que Steiner s’inscrit dans la filiation de Goethe, dont l’ « empirisme délicat » valorisait l’intuition et l’imagination pour comprendre la nature. En intégrant des éléments ésotériques et analogiques, Steiner proposa une alternative au réductionnisme scientifique et à l’industrialisation de l’agriculture. La biodynamie fut ensuite théorisée et diffusée par ses disciples, comme Ehrenfried Pfeiffer, et inspira plus largement les mouvements environnementalistes.
L’autrice confronte cette tradition à la notion de patrimoine culturel. Si le patrimoine alimentaire est aujourd’hui un champ institutionnalisé (notamment par l’UNESCO), la biodynamie reste largement absente de ces dispositifs, en partie parce que ses dimensions spirituelles sont jugées incompatibles avec les critères de la science matérialiste et réductionniste. Paradoxalement, certaines régions viticoles prestigieuses (Bourgogne, par ex.) utilisent largement la biodynamie pour produire des vins de terroir inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, sans que la contribution de la biodynamie soit mentionnée. De leur côté, les institutions anthroposophiques comme le Goetheanum entretiennent la mémoire de Steiner et organisent en 2024 des célébrations autour du centenaire de son Cours d’agriculture, conçue comme une transmission culturelle, bien que rarement désignée explicitement comme « patrimoine ».
Sur le terrain, les anthropologues montrent que les praticiens s’approprient la biodynamie de manière souple et créative. Certains la « sécularisent » en l’adaptant à des cadres scientifiques, d’autres y ajoutent des références spirituelles locales. En Inde, elle s’articule aisément aux croyances hindoues sur la vache sacrée et les influences astrologiques ; en Nouvelle-Zélande, elle entre en résonance avec la cosmologie maorie. Dans les vignobles européens, elle est mobilisée pour exprimer l’authenticité du terroir et se démarquer des logiques industrielles. Ces adaptations soulignent ce que Viecelli appelle la « porosité culturelle » de la biodynamie.
Plutôt qu’un patrimoine fixé par des institutions, la biodynamie apparaît comme une pratique performative de soin. Les gestes rituels (préparation, dynamisation, observation des cycles lunaires) ne sont pas seulement des techniques : ils cultivent l’attention, la relation au sol, aux plantes et aux dimensions invisibles du réel. Dans cette perspective, la biodynamie ne valorise pas un lieu ou une tradition figée, mais ouvre une voie globale de résonance entre humains et non-humains. Elle rejoint ainsi les débats critiques dans le champ de l’héritage, qui insistent sur le patrimoine comme pratique vivante, relationnelle et située, plutôt que comme simple conservation.
En conclusion, Viecelli suggère que si la biodynamie n’est pas reconnue officiellement comme patrimoine culturel, c’est peut-être parce qu’elle est encore « vivante » et dynamique. Dans un contexte de crise environnementale, elle offre un modèle alternatif de transmission culturelle, où patrimoine, durabilité et spiritualité se conjuguent. Ainsi, la biodynamie peut être comprise comme une forme émergente de patrimoine dialogique et global, enracinée dans la mémoire de Steiner mais constamment réinventée par ses praticiens.